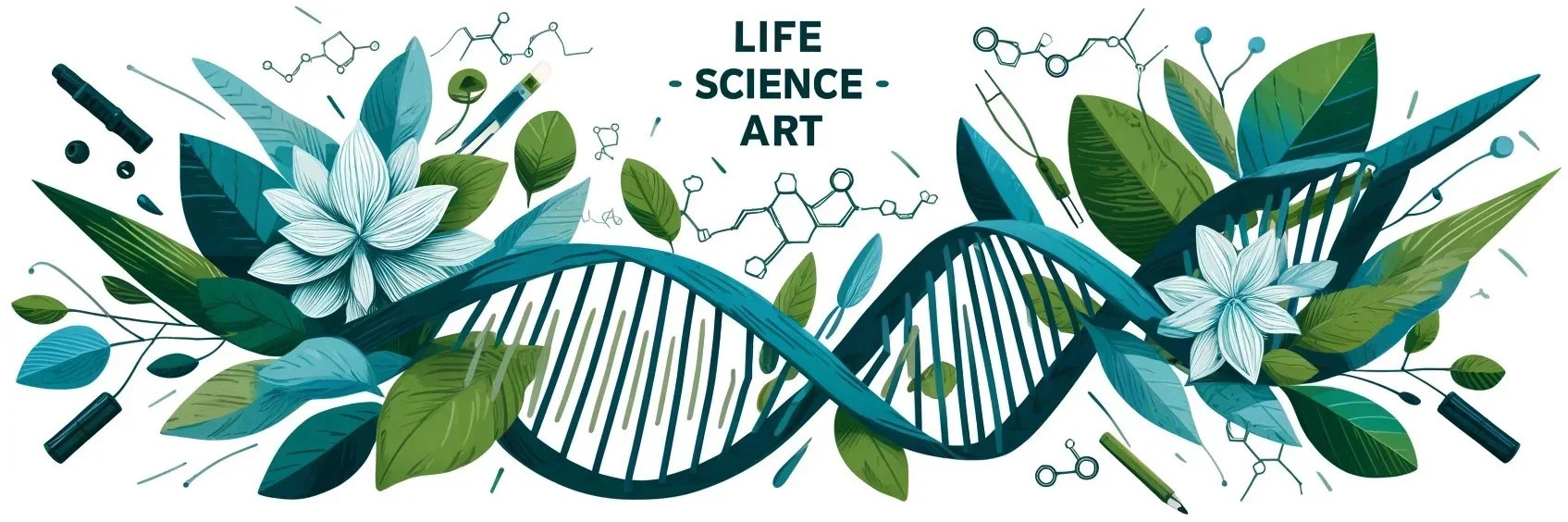Les blessures de l’Albertosaurus éclairent les interactions des dinosaures anciens
Découverte d’une mâchoire blessée d’Albertosaurus
Le fossile TMP 2003.45.64 n’est peut-être pas le plus accrocheur, mais pour les paléontologues, il contient de précieux indices sur la vie des dinosaures anciens. Cette mâchoire inférieure d’un Albertosaurus, un grand tyrannosaure, porte une série d’entailles qui révèlent une histoire de rencontres préhistoriques.
Morsures de tyrannosaure
Les entailles sur la mâchoire de l’Albertosaurus ont été déterminées comme ayant été infligées par les dents d’un autre tyrannosaure. Ce type de blessure a été observé sur d’autres fossiles de tyrannosaures, indiquant que ces prédateurs massifs se livraient souvent à des morsures au visage lors de combats. Le modèle de dommages distingue les marques de morsure de tyrannosaure des lésions causées par des micro-organismes.
Morsures multiples
Curieusement, la mâchoire d’Albertosaurus décrite par Phil Bell dans son étude présentait des preuves de deux événements de morsure distincts. Une rainure profonde près de l’avant de la mâchoire était fraîche et lisse, tandis que trois traces de dents parallèles et une plaie perforante plus en arrière avaient cicatrisé. Cela suggère que l’Albertosaurus a survécu à un combat avec un autre tyrannosaure, mais a subi une deuxième morsure vers le moment de sa mort.
Autres découvertes pathologiques
La mâchoire blessée n’était pas le seul os trouvé dans l’ossuaire du parc provincial de Dry Island Buffalo Jump qui présentait des caractéristiques pathologiques. Bell a identifié cinq autres os présentant des anomalies, notamment des côtes et des os des orteils endommagés provenant d’individus différents. Les côtes avaient été fracturées et guéries, tandis que les os des orteils présentaient des éperons osseux appelés enthésophytes, qui se forment au niveau des insertions ligamentaires ou tendineuses. La signification de ces lésions osseuses des orteils reste incertaine, car les enthésophytes peuvent se développer en raison de divers facteurs.
Faible incidence de pathologie
Malgré la découverte de ces os pathologiques, Bell a noté que l’incidence globale des blessures parmi les 26 individus d’Albertosaurus examinés était relativement faible, avec seulement six blessures chez deux individus. Cela contraste avec les ossuaires d’autres grands dinosaures prédateurs, tels que l’Allosaurus et le Majungasaurus, qui ont montré des taux de pathologie plus élevés. La raison de cette différence de prévalence des blessures reste un mystère.
Importance paléopathologique
Les blessures et les maladies chez les dinosaures peuvent fournir des informations précieuses sur leur comportement, leurs interactions écologiques et leur état de santé. L’étude de la paléopathologie, l’analyse des changements pathologiques chez les organismes anciens, permet aux chercheurs de reconstituer la vie d’animaux disparus et de comprendre les défis auxquels ils étaient confrontés.
Dynamique de la population d’Albertosaurus
La faible incidence de pathologie dans la population d’Albertosaurus de Dry Island suggère que ces dinosaures étaient peut-être moins sujets aux blessures que d’autres espèces de tyrannosaures. Cela pourrait être dû à des facteurs tels que leur habitat, la disponibilité des proies ou la structure sociale. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer ces possibilités et acquérir une compréhension plus approfondie de la dynamique de la population d’Albertosaurus.
Comparaisons avec d’autres ossuaires de dinosaures
La comparaison des taux de pathologie dans différents ossuaires de dinosaures peut fournir des informations précieuses sur les facteurs environnementaux et écologiques qui ont influencé la santé et la survie des dinosaures. La plus faible incidence de pathologie dans la population d’Albertosaurus de Dry Island par rapport aux autres ossuaires de tyrannosaures soulève des questions sur les caractéristiques uniques de cet écosystème particulier.
Axes de recherche futurs
La découverte d’os blessés dans la population d’Albertosaurus ouvre de nouvelles voies pour la recherche paléopathologique. Les études futures pourraient se concentrer sur l’identification de spécimens pathologiques supplémentaires, l’étude des causes et des conséquences des blessures et la comparaison de l’état de santé de différentes espèces et populations de dinosaures. Ces recherches amélioreront notre compréhension de la paléoécologie des dinosaures et des défis auxquels ils ont été confrontés dans leurs anciens environnements.