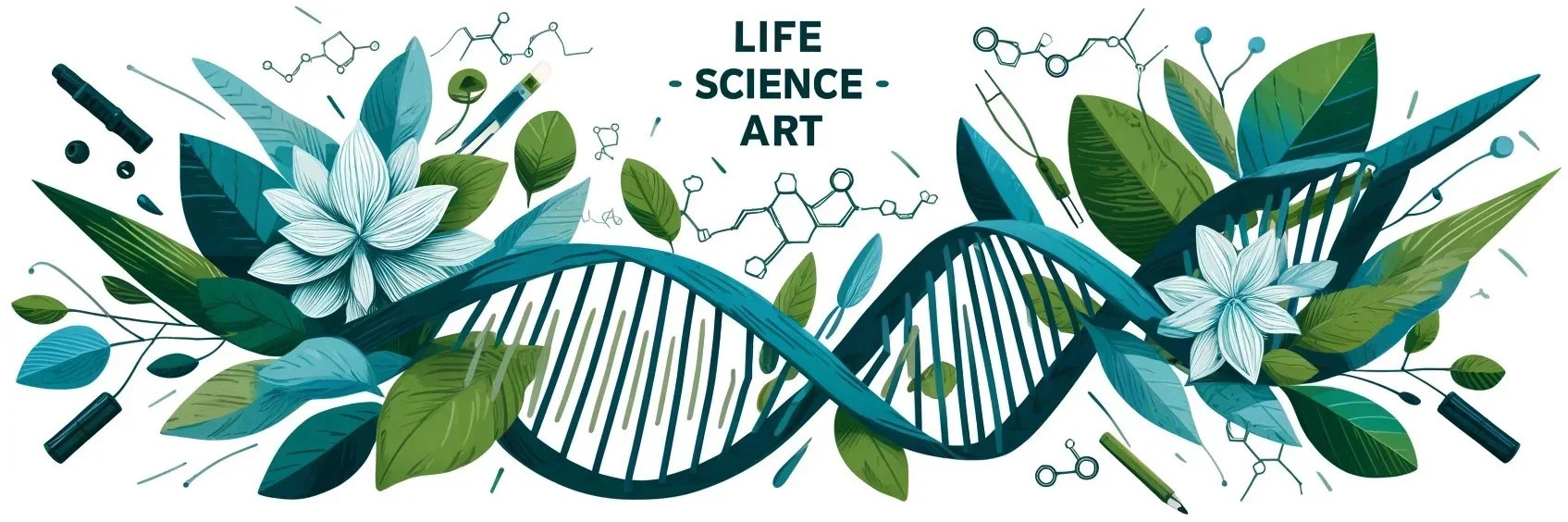Comment nettoyer un moulin à café : un guide complet
Introduction
Entretenir un moulin à café propre est essentiel pour préparer la tasse de café parfaite. Les huiles des grains peuvent s’accumuler et rancir, gâchant la saveur de votre boisson. Ce guide fournira des instructions détaillées sur la façon de nettoyer les moulins à café à lames et à meules, ainsi que des conseils pour garder votre moulin propre plus longtemps.
À quelle fréquence nettoyer un moulin à café
Si vous utilisez votre moulin à café quotidiennement, un nettoyage rapide est recommandé chaque semaine. Cela évitera l’accumulation d’huiles et garantira que votre moulin fonctionne de manière optimale. Même les utilisateurs occasionnels devraient nettoyer leurs moulins avant de les ranger pour éliminer tout résidu d’huile.
Types de moulins à café
Il existe deux principaux types de moulins à café : à lames et à meules.
- Moulins à lames : Utilisent une lame qui tourne rapidement pour pulvériser les grains de café. Ils sont peu coûteux et existent en différentes tailles.
- Moulins à meules : Utilisent des disques dentés plats ou coniques pour moudre les grains de café. Ils produisent une mouture plus uniforme et sont préférés par les amateurs de café.
Matériel et outils
Pour les moulins à lames et à meules :
- Chiffon en microfibre
- Évier ou grand bol
- Brosse à poils durs pour bouteilles
- Éponge non abrasive
Supplémentaire pour les moulins à lames :
- 1/4 tasse de riz cru ou pastilles de nettoyage pour moulins à café
Instructions
Comment nettoyer un moulin à café à lames
- Ajouter du riz ou des pastilles de nettoyage : Verser le riz ou les pastilles dans la trémie du moulin.
- Faire fonctionner le moulin : Allumer le moulin et moudre jusqu’à ce que le riz ou les pastilles soient pulvérisés.
- Éteindre le moulin : Débrancher le moulin et vider la trémie.
- Essuyer : Humidifier un chiffon en microfibre et essuyer l’intérieur et l’extérieur